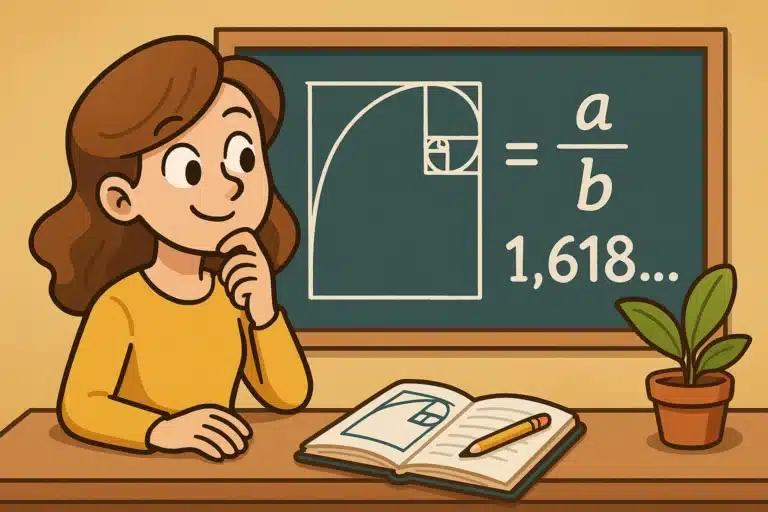Comment évaluer la fiabilité d’un test de dépistage ?

Introduction
En médecine, on utilise de plus en plus de tests de dépistage pour détecter des maladies le plus tôt possible. Mais un test n’est jamais parfait : il peut se tromper, donner des faux positifs ou des faux négatifs. La question devient alors essentielle : comment savoir si un test est vraiment fiable, et comment les mathématiques peuvent nous aider à l’évaluer ?
I. Les probabilités dans un test de dépistage
1. Sensibilité et spécificité
Lorsqu’on parle de la fiabilité d’un test médical, on utilise deux probabilités fondamentales :
- La sensibilité est la probabilité que le test soit positif si la personne est malade : [math]\text{Sensibilité} = \mathbb{P}(\text{Test+ | Malade})[/math].
- La spécificité est la probabilité que le test soit négatif si la personne n’est pas malade : [math]\text{Spécificité} = \mathbb{P}(\text{Test- | Non malade})[/math].
Exemple : Un test a [math]95\%[/math] de sensibilité et [math]90\%[/math] de spécificité.
- Cela signifie que [math]95\%[/math] des malades seront correctement détectés.
- Mais aussi que [math]10\%[/math] des non malades auront quand même un résultat positif → ce sont les faux positifs.
2. Le tableau de contingence
Pour bien visualiser ces probabilités, on utilise un tableau à double entrée.
Supposons une population de 1000 personnes, dont 5 % sont malades.
- Cela fait [math]1000 \times 0,05 = 50[/math] malades,
- et [math]950[/math] non malades.
Appliquons le test :
- Parmi les 50 malades :
- 95 % sont bien détectés → [math]50 \times 0,95 = 47{,}5 \approx 48[/math] vrais positifs.
- 5 % ne sont pas détectés → [math]50 \times 0,05 = 2{,}5 \approx 2[/math] faux négatifs.
- Parmi les 950 non malades :
- 90 % sont bien détectés → [math]950 \times 0,90 = 855[/math] vrais négatifs.
- 10 % sont mal classés → [math]950 \times 0,10 = 95[/math] faux positifs.
On peut résumer dans un tableau :
| Malade (50) | Non malade (950) | Total | |
|---|---|---|---|
| Test + | 48 (vrais positifs) | 95 (faux positifs) | 143 |
| Test – | 2 (faux négatifs) | 855 (vrais négatifs) | 857 |
| Total | 50 | 950 | 1000 |
Ce tableau met en évidence que même avec un bon test, il y a toujours des erreurs (faux positifs…).
II. Les probabilités conditionnelles et le théorème de Bayes
1. Probabilité d’être malade sachant que le test est positif
Si le test est positif, quelle est la probabilité que la personne soit réellement malade ?
C’est exactement la formule de Bayes :
\mathbb{P}(\text{Malade | Test+}) = \dfrac{\mathbb{P}(\text{Test+ | Malade}) \times \mathbb{P}(\text{Malade})}{\mathbb{P}(\text{Test+})}.Application avec les données de la partie I :
- Sensibilité : [math]\mathbb{P}(\text{Test+ | Malade}) = 0{,}95[/math]
- Prévalence (proportion de malades) : [math]\mathbb{P}(\text{Malade}) = 0{,}05[/math]
- Probabilité totale d’un test positif :
\mathbb{P}(\text{Test+}) = \mathbb{P}(\text{Test+ | Malade}) \times \mathbb{P}(\text{Malade}) + \mathbb{P}(\text{Test+ | Non malade}) \times \mathbb{P}(\text{Non malade})= 0{,}95 \times 0{,}05 + 0{,}10 \times 0{,}95 = 0{,}0475 + 0{,}095 = 0{,}1425.On en déduit :
\mathbb{P}(\text{Malade | Test+}) = \dfrac{0{,}95 \times 0{,}05}{0{,}1425} \approx 0{,}333.Interprétation : Même si le test est positif, la probabilité réelle d’être malade n’est que d’environ 33 %.
2. Effet de la prévalence de la maladie
Un point fondamental est que la prévalence (la fréquence de la maladie dans la population) a un impact énorme sur la fiabilité d’un test.
Exemple comparatif :
- Si la prévalence est de [math]5 %[/math] (comme dans la partie I), on a :
[math]\mathbb{P}(\text{Malade | Test+}) \approx 33 %[/math]. - Si la prévalence est seulement de [math]1 %[/math], alors :
- [math]\mathbb{P}(\text{Malade}) = 0{,}01[/math],
- [math]\mathbb{P}(\text{Test+}) = 0{,}95 \times 0{,}01 + 0{,}10 \times 0{,}99 = 0{,}0095 + 0{,}099 = 0{,}1085[/math],
- [math]\mathbb{P}(\text{Malade | Test+}) = \dfrac{0{,}0095}{0{,}1085} \approx 0{,}0876[/math].
Résultat : la valeur prédictive positive tombe à 8,8 % seulement.
Un test peut avoir une bonne sensibilité et spécificité, mais sa fiabilité réelle dépend de la prévalence de la maladie :
- si la maladie est fréquente, un test positif est souvent fiable,
- si la maladie est rare, un test positif risque souvent d’être un faux positif.
C’est une des raisons pour lesquelles en médecine, les tests de dépistage doivent être interprétés avec prudence et souvent confirmés par d’autres examens.
III. Optimisation de la fiabilité d’un test
De nombreux tests médicaux ne sont pas «oui/non», mais reposent sur une valeur mesurée (par exemple, la quantité d’anticorps dans le sang).
On fixe alors un seuil pour dire si le test est positif.
- Si on baisse le seuil → le test devient très sensible (on détecte presque tous les malades) → peu de faux négatifs mais beaucoup de faux positifs.
- Si on augmente le seuil → le test devient très spécifique (on détecte bien les non malades) → peu de faux positifs mais plus de faux négatifs.
Exemple simplifié :
- Seuil bas → sensibilité [math]99 %[/math], spécificité [math]80 %[/math].
- Seuil haut → sensibilité [math]80 %[/math], spécificité [math]99 %[/math].
Selon la maladie, le choix est crucial :
- Pour une maladie grave, on préfère éviter les faux négatifs → on privilégie la sensibilité.
- Pour une maladie bénigne mais fréquente, on veut éviter d’inquiéter inutilement → on privilégie la spécificité.
Conclusion
Les mathématiques ne guérissent pas, mais elles permettent de mesurer la fiabilité d’un test, d’anticiper ses limites et de mieux interpréter ses résultats. Grâce aux probabilités et aux statistiques, on comprend qu’un test n’est jamais absolu, mais qu’il reste un outil précieux pour orienter les décisions médicales.
On espère que ce sujet vous aidera, et que vous saurez l’exploiter au mieux pour briller à votre épreuve !