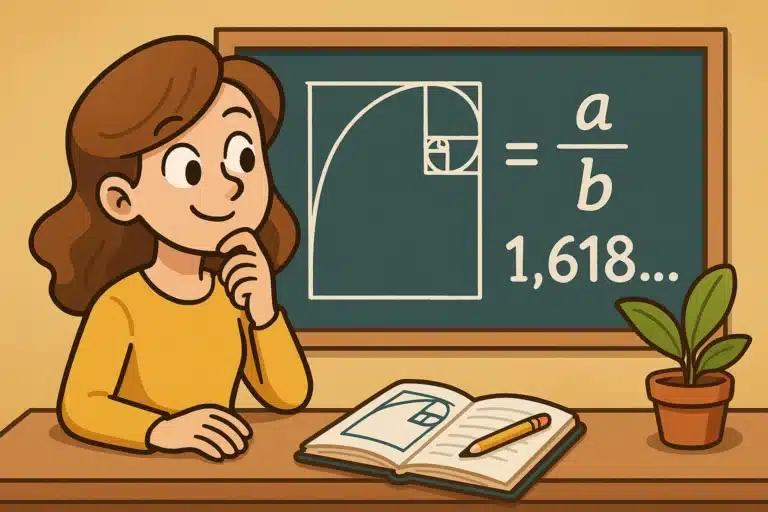Le paradoxe des deux enveloppes

Introduction
Quand on parle de paradoxes en mathématiques, on pense souvent à des situations où le raisonnement semble correct… mais mène pourtant à une conclusion absurde.
Le paradoxe des deux enveloppes en est un bel exemple : deux enveloppes, de l’argent à l’intérieur, et une question simple : faut-il changer d’enveloppe pour maximiser son gain ? À première vue, les calculs paraissent montrer qu’il vaut toujours mieux changer. Mais si c’était vrai, on devrait changer indéfiniment, ce qui est absurde. C’est là que les probabilités et l’espérance mathématique révèlent toute leur importance.
I. Le paradoxe : une situation trompeuse
1. Présentation du problème
Imaginons deux enveloppes :
- l’une contient une somme d’argent [math]X[/math],
- l’autre contient exactement le double, soit [math]2X[/math].
On choisit au hasard une des deux enveloppes. Supposons que tu découvres le contenu : par exemple, 50 €.
Le raisonnement intuitif est le suivant :
- Si les 50 € représentent la petite enveloppe ([math]X = 50[/math]), alors l’autre contient [math]2X = 100[/math].
- Si au contraire les 50 € représentent la grande enveloppe ([math]2X = 50 \Rightarrow X=25[/math]), alors l’autre contient [math]X = 25[/math].
Dans ce raisonnement, on attribue une probabilité [math]\tfrac{1}{2}[/math] à chacun des cas (50 € = petite ou grande).
On calcule donc l’espérance du gain si on change :
\mathbb{E}[\text{gain}] = \tfrac{1}{2} \cdot (2X) + \tfrac{1}{2} \cdot \left(\tfrac{X}{2}\right) = \tfrac{5}{4}X.Or, comme [math]\tfrac{5}{4}X > X[/math], cela semble prouver qu’il est toujours préférable de changer d’enveloppe.
2. Pourquoi c’est paradoxal
À première vue, l’argument paraît correct. Pourtant, il conduit à une absurdité :
- Si tu changes une première fois, les calculs disent qu’il faut encore changer.
- Mais si tu changes à nouveau, le même raisonnement s’applique… donc tu devrais encore changer !
En suivant cette logique, tu serais poussé à changer indéfiniment, ce qui n’a aucun sens.
La source du paradoxe vient du fait qu’on mélange :
- une valeur fixe observée (par ex. 50 €),
- avec des probabilités mal définies (on suppose à tort que c’est [math]50/50[/math] d’avoir la petite ou la grande enveloppe, même après avoir ouvert).
Pour comprendre pourquoi ce raisonnement échoue, il faut analyser le rôle de l’espérance mathématique et des probabilités conditionnelles.
II. L’espérance mathématique et ses pièges
1. Rappel : l’espérance en probabilités
En probabilités, si [math]X[/math] est une variable aléatoire discrète prenant des valeurs [math]x_i[/math] avec des probabilités [math]p_i[/math], alors l’espérance est définie par :
\mathbb{E}[X] = \sum_i p_i \cdot x_i.C’est une moyenne théorique : elle représente la valeur qu’on obtiendrait «en moyenne» si l’on répétait l’expérience un grand nombre de fois.
Exemple concret : pour un dé équilibré à 6 faces, la variable [math]X[/math] peut prendre les valeurs [math]1,2,3,4,5,6[/math] avec probabilité [math]\tfrac{1}{6}[/math] chacune.
On calcule :
\mathbb{E}[X] = \tfrac{1}{6}(1+2+3+4+5+6) = 3,5.Cela signifie qu’en moyenne, un lancer de dé vaut 3,5. Bien sûr, on n’obtiendra jamais 3,5 en pratique : l’espérance n’est pas un gain garanti, mais une valeur moyenne idéale.
2. Erreur dans le paradoxe des deux enveloppes
Dans le raisonnement naïf du paradoxe, on suppose :
«Après avoir ouvert l’enveloppe et observé une somme (par ex. 50 €), il y a 50 % de chances que ce soit la petite enveloppe et 50 % de chances que ce soit la grande.»
Le cœur du paradoxe est qu’on essaie de calculer une espérance sans avoir défini correctement la loi de probabilité de [math]X[/math].
En réalité :
- Si on ne connaît pas la distribution de [math]X[/math], alors l’espérance [math]\mathbb{E}[X][/math] est indéfinissable : on ne peut rien conclure.
- Si les montants sont bornés, tout change.
Exemple avec des enveloppes contenant entre [math]1[/math] € et [math]100[/math] € :
- Si on tire [math]100[/math] €, c’est forcément la grande enveloppe (car [math]200[/math] € est exclu).
- Si on tire [math]1[/math] €, c’est forcément la petite enveloppe (car [math]0,5[/math] € est exclu).
- Si on tire [math]50[/math] €, alors il y a une ambiguïté : ça peut être soit la petite ([math]X=50[/math], l’autre vaut [math]100[/math]) soit la grande ([math]X=100[/math], l’autre vaut [math]50[/math]).
Ainsi, la «supériorité» systématique du changement disparaît dès qu’on raisonne correctement avec une loi de probabilité bien définie.
III. Limites des raisonnements intuitifs
1. Ce que le paradoxe des enveloppes nous apprend
Ce paradoxe illustre une leçon essentielle :
- En probabilités, il ne suffit pas de manipuler des formules.
- Il faut définir clairement les hypothèses (ici : quelle est la distribution de [math]X[/math] ?).
La rigueur dans la définition des variables et des lois de probabilité est donc super importante. Ce paradoxe rappelle qu’un raisonnement «séduisant» peut être trompeur si les hypothèses de départ sont mal posées.
Applications possibles :
- En économie : choix sous incertitude (ex. investir ou non).
- En intelligence artificielle : quand un modèle doit décider entre deux options sans connaître toute la distribution.
- En jeux de hasard : illusions de gain basées sur des calculs d’espérance incorrects.
2. Exemple classique d’erreur liée au manque de rigueur
Un exemple simple de la vie courante illustre bien ce type d’erreur : la notion de vitesse moyenne.
Imaginons un trajet de [math]100[/math] km.
- À l’aller, une voiture roule à [math]100[/math] km/h.
- Au retour, elle roule à [math]50[/math] km/h.
On pourrait croire que la vitesse moyenne est simplement la moyenne des deux vitesses :
v_m = \tfrac{100 + 50}{2} = 75 \ \text{km/h}.Mais c’est faux!!
En réalité, la vitesse moyenne se définit par :
v_m = \tfrac{\text{distance totale}}{\text{temps total}}.Or ici, la distance totale est :
d = 100 + 100 = 200 \ \text{km}.- Temps à l’aller :
[math]t_1 = \tfrac{100}{100} = 1 \ \text{h}.[/math] - Temps au retour :
[math]t_2 = \tfrac{100}{50} = 2 \ \text{h}.[/math]
Donc le temps total est :
t = t_1 + t_2 = 1 + 2 = 3 \ \text{h}.La vitesse moyenne est donc :
v_m = \tfrac{d}{t} = \tfrac{200}{3} \approx 66{,}7 \ \text{km/h}.Ce résultat est très différent de [math]75[/math] km/h.
Cet exemple montre que, comme dans le paradoxe des deux enveloppes, un raisonnement intuitif mais mal défini peut mener à une conclusion fausse. La rigueur en mathématiques est essentielle : même lorsqu’un problème paraît simple, il faut toujours bien poser les définitions et les hypothèses avant de calculer.
Conclusion
Ainsi, le paradoxe des deux enveloppes montre qu’en probabilités, sans hypothèses claires, même un calcul simple peut mener à l’absurde.
On espère que ce sujet vous aidera, et que vous saurez l’exploiter au mieux pour briller à votre épreuve !