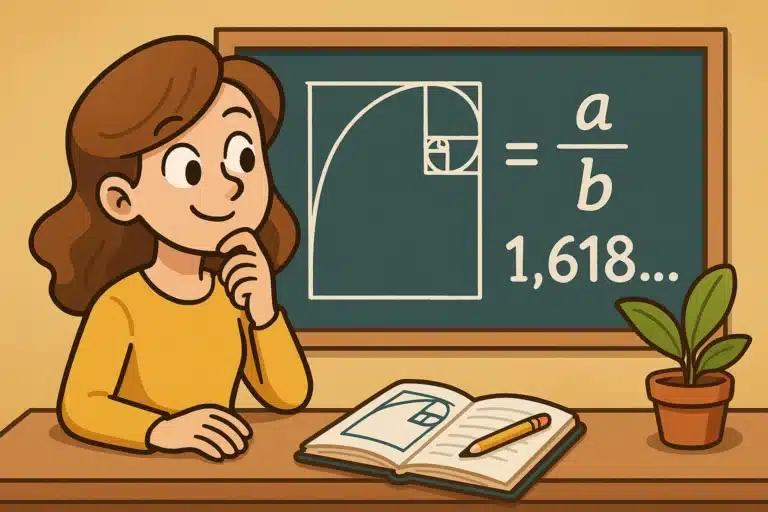Le paradoxe de Saint-Pétersbourg

Introduction
Parfois, les mathématiques nous réservent des surprises qui bousculent complètement notre intuition. C’est le cas du paradoxe de Saint-Pétersbourg, un problème célèbre inventé au XVIIIᵉ siècle autour d’un simple jeu de pile ou face.
I. Présentation du paradoxe et mise en équation
1. La règle du jeu
On considère un jeu aléatoire avec une pièce équilibrée (probabilité [math]\tfrac12[/math] pour «pile», [math]\tfrac12[/math] pour «face»).
On lance la pièce jusqu’à obtenir pour la première fois «pile». Le gain dépend du rang du premier «pile» :
- «pile» au 1er lancer [math]\Rightarrow[/math] gain [math]2[/math] € ;
- «pile» au 2e lancer [math]\Rightarrow[/math] gain [math]4[/math] € ;
- «pile» au [math]k[/math]-ième lancer [math]\Rightarrow[/math] gain [math]2^k[/math] €.
Autrement dit, si l’on note [math]X[/math] la variable aléatoire «gain du joueur», alors :
\quad X = 2^K \quad \text{où } K \text{ est le rang du premier «pile».}La loi de [math]K[/math] est géométrique (version «nombre d’essais jusqu’au premier succès») :
\mathbb{P}(K = k) = \left(\tfrac12\right)^k \quad (k \ge 1),car il faut [math]k-1[/math] fois «face» puis «pile» au [math]k[/math]-ième lancer.
On en déduit la loi de [math]X[/math] :
\mathbb{P}(X = 2^k) = \mathbb{P}(K = k) = \left(\tfrac12\right)^k \quad (k \ge 1).2. Calcul de l’espérance
Par définition (loi discrète), l’espérance du gain est :
\displaystyle \mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} (2^k)\mathbb{P}(X=2^k) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \left(\tfrac12\right)^k.Or :
2^k\left(\tfrac12\right)^k = \left(2 \cdot \tfrac12\right)^k = 1^k = 1.
Donc la série devient simplement :
\displaystyle \mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} 1 = +\infty.Conclusion (paradoxale) : l’espérance du gain est infinie. D’un point de vue purement théorique, on pourrait en déduire qu’il serait «rationnel» d’accepter de payer n’importe quel prix pour jouer… ce que personne ne fait en réalité. C’est précisément là le paradoxe de Saint-Pétersbourg : une espérance mathématique infinie qui contredit le bon sens économique.
II. Pourquoi l’intuition est trompeuse
1. Confrontation avec la réalité
À première vue, une espérance infinie devrait rendre ce jeu «imbattable». Pourtant, dans la pratique, personne ne serait prêt à miser une fortune pour y jouer. Pourquoi ? Parce que les gros gains sont extrêmement rares.
Prenons quelques exemples numériques :
- Pour gagner au moins [math]16[/math] € (ce qui correspond à obtenir «pile» au plus tard au 4ᵉ lancer, donc gain [math]\geq 2^4 = 16[/math]), la probabilité est :
\mathbb{P}(X \geq 16) = \left(\tfrac12\right)^4 = \tfrac{1}{16} \approx 6,25 \%.- Pour gagner au moins [math]1000[/math] € (donc «pile» seulement après 10 lancers, puisque [math]2^{10} = 1024[/math]), la probabilité tombe à :
\mathbb{P}(X \geq 1000) = \left(\tfrac12\right)^{10} = \tfrac{1}{1024} \approx 0,1 \%.Autrement dit, les sommes astronomiques qui rendent l’espérance «infinie» arrivent si rarement qu’un joueur réel n’a pratiquement aucune chance de les voir.
2. Les limites de l’espérance mathématique
Le cœur du paradoxe, c’est que l’espérance mathématique additionne toutes les possibilités, même celles qui ont une probabilité minuscule. Formellement :
\mathbb{E}[X] = 2 \cdot \tfrac12 + 4 \cdot \tfrac14 + 8 \cdot \tfrac18 + \dots = +\infty.Chaque terme du calcul vaut [math]1[/math], même si la probabilité de ces événements devient infime. C’est pour cela que la somme diverge.
Mais l’espérance ne reflète pas ce qu’un joueur va réellement expérimenter.
- Exemple : si on joue 100 parties, le gain observé sera souvent composé de nombreux petits gains (2 €, 4 €, parfois 8 €), avec peut-être un seul gros gain, mais jamais une moyenne infinie.
- En fait, les statistiques montrent que le gain moyen observé après un grand nombre de parties reste relativement modeste, et très loin de l’espérance « infinie ».
Autrement dit, l’espérance mathématique est un outil théorique puissant, mais elle peut être trompeuse quand les événements rares pèsent trop lourd dans le calcul.
Pour comprendre pourquoi ce paradoxe ne correspond pas à l’expérience humaine, il faut donc introduire d’autres notions que la simple espérance : l’utilité et la manière dont les individus évaluent les risques.
III. Résolutions et prolongements
1. La solution de Daniel Bernoulli (1738) : l’utilité logarithmique
Pour résoudre le paradoxe, Daniel Bernoulli propose en 1738 une idée révolutionnaire : ce n’est pas le gain monétaire en lui-même qui compte, mais la satisfaction (ou utilité) que l’on en retire.
Autrement dit : gagner 100 € n’apporte pas 10 fois plus de «bonheur» que gagner 10 €. Le ressenti de la valeur croît moins vite que la somme.
Bernoulli modélise cette idée avec une fonction d’utilité croissante mais concave, par exemple :
U(x) = \ln(x).
Espérance de l’utilité
Reprenons le jeu de Saint-Pétersbourg. Si le premier «pile» apparaît au [math]k[/math]-ième lancer, on gagne [math]2^k[/math]. L’utilité correspondante est :
U(2^k) = \ln(2^k) = k \ln(2).
La probabilité de cet événement est [math]\left(\tfrac{1}{2}\right)^k[/math].
Donc l’espérance de l’utilité est :
\mathbb{E}[U(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\tfrac{1}{2}\right)^k \cdot k \ln(2).On peut sortir [math]\ln(2)[/math] du calcul :
\mathbb{E}[U(X)] = \ln(2) \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \tfrac{k}{2^k}. Or, on sait que :
\sum_{k=1}^{\infty} \tfrac{k}{2^k} = 2.Donc :
\mathbb{E}[U(X)] = 2 \ln(2) \approx 1{,}386.Résultat : avec l’utilité logarithmique, l’espérance est finie. Le paradoxe disparaît : il n’y a plus de raison de payer une somme illimitée pour jouer.
Interprétation
Cela correspond à notre intuition : un joueur est prêt à miser quelques euros pour participer, car les gains élevés ont une utilité marginale de plus en plus faible.
En d’autres termes, le risque est pondéré par la psychologie humaine : nous n’accordons pas la même valeur à chaque euro gagné.
2. Applications et leçons pour les probabilités
Ce paradoxe a marqué un tournant dans l’histoire des probabilités, car il montre que l’espérance mathématique n’est pas toujours l’indicateur pertinent pour la prise de décision.
- Économie et finance : la théorie de l’utilité est devenue centrale pour comprendre les comportements des investisseurs.
Exemple : un trader ne choisira pas seulement l’actif avec la meilleure espérance de gain, mais celui qui maximise son utilité compte tenu du risque. - Assurance : pourquoi payer une prime annuelle (certain coût) pour se protéger d’un risque rare mais potentiellement énorme ? Parce que la perte de 10 000 € a une utilité négative bien plus grande que le gain de 10 000 €.
- Informatique et intelligence artificielle : les algorithmes de décision sous incertitude utilisent des fonctions d’utilité pour choisir entre plusieurs actions. Par exemple, un robot autonome ne se contente pas d’optimiser une espérance de gain brute, il intègre des pénalités liées aux risques d’échec.
Enseignement final : le paradoxe de Saint-Pétersbourg illustre une idée clé en mathématiques appliquées : les formules seules ne suffisent pas. Il faut bien définir ce que l’on mesure (ici : gain monétaire ou utilité perçue).
Conclusion
Le paradoxe de Saint-Pétersbourg nous rappelle qu’en probabilités, il ne suffit pas de suivre les calculs : il faut aussi prendre en compte la réalité et la façon dont on évalue le risque. C’est une belle leçon de rigueur… et d’humilité face aux maths.
On espère que ce sujet vous aidera, et que vous saurez l’exploiter au mieux pour briller à votre épreuve !