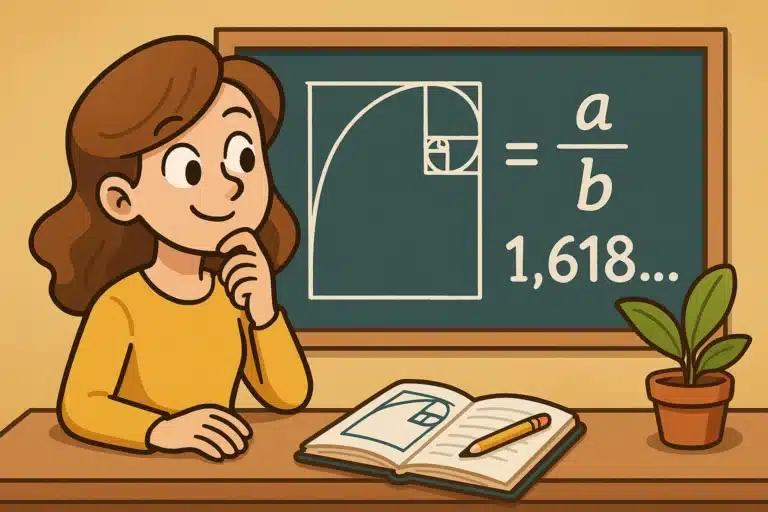Probabilités et erreur judiciaire : l’affaire Sally Clark
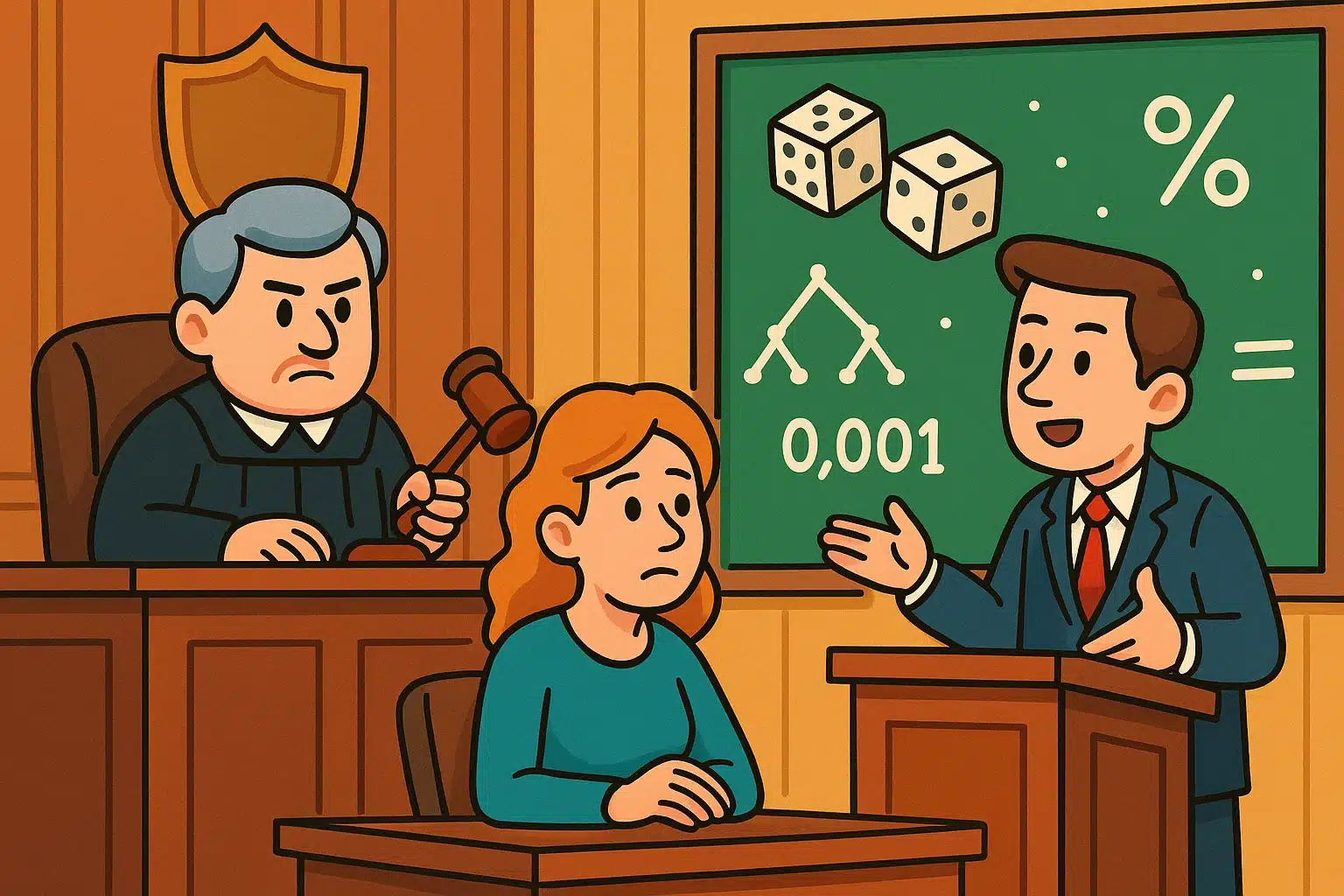
Introduction
En 1999, en Angleterre, une avocate nommée Sally Clark est accusée d’avoir tué ses deux enfants. Ce qui a pesé lourd contre elle, ce n’est pas une preuve matérielle, mais un calcul de probabilité présenté comme scientifique. Cet exemple montre à quel point une mauvaise utilisation des maths peut avoir des conséquences dramatiques…
I. Contexte et présentation de l’affaire
1. Qui est Sally Clark ?
Sally Clark était une avocate britannique. En 1999, elle est accusée d’avoir tué ses deux enfants, tous deux décédés brutalement avant l’âge de quelques mois.
Au départ, les décès pouvaient être expliqués par le syndrome de mort subite du nourrisson. Mais les médecins légistes trouvent suspect qu’un tel drame se produise deux fois dans la même famille. Ils commencent alors à envisager la piste d’un double infanticide, et Sally Clark se retrouve sur le banc des accusés.
2. L’argument mathématique au procès
Au procès, un pédiatre expert, Sir Roy Meadow, avance un argument probabiliste qui va peser lourd dans le jugement. Il explique que :
- selon les statistiques, la probabilité qu’un enfant meure de mort subite dans une famille «favorisée» (non-fumeurs, bonne situation) est d’environ [math]\tfrac{1}{73000}[/math].
- donc, la probabilité que deux enfants de la même famille meurent de cette manière est :
\tfrac{1}{73000}\times\tfrac{1}{73000} = \tfrac{1}{5329000000} \approx 1 \text{ sur 5 millions}.Présentée au jury, cette estimation donne l’impression qu’il est pratiquement impossible que les deux décès soient dus au hasard. Cet argument a eu une influence énorme : il a renforcé l’idée que Sally Clark devait forcément être coupable.
Voici une petite vidéo que vous pouvez utiliser pour construire votre propre sujet 🙂
II. Analyse probabiliste et erreurs de raisonnement
1. Erreur de multiplication des probabilités (indépendance mal posée)
Au procès, l’expert a multiplié [math]\tfrac{1}{73000} \times \tfrac{1}{73000}[/math] comme si les deux morts subites étaient indépendantes.
Or, l’indépendance signifie que la réalisation du premier événement ne change pas la probabilité du second :
P(A\cap B)=P(A)\times P(B)\quad\text{si et seulement si}\quad A\ \text{et}\ B\ \text{sont indépendants.}Ici, il est plausible que la probabilité d’une deuxième mort subite augmente si une première est survenue (facteurs génétiques, environnement commun, etc.). Autrement dit, on s’attend plutôt à :
P(\text{2ᵉ mort subite} \mid \text{1ʳᵉ mort subite}) > P(\text{mort subite}).Donc la bonne écriture est une probabilité conditionnelle :
P(\text{deux morts subites}) = P(\text{1ʳᵉ mort subite})\times P(\text{2ᵉ mort subite}\mid \text{1ʳᵉ mort subite}),et pas [math]p\times p[/math] avec [math]p=\tfrac{1}{73000}[/math].
Si, par exemple, des facteurs familiaux multipliaient par 10 le risque pour le second enfant, on aurait (chiffres illustratifs) :
P(\text{deux morts subites}) \approx \tfrac{1}{73000}\times \tfrac{10}{73000} = \tfrac{10}{(73000)^2},ce qui est déjà 10 fois plus grand que le produit naïf. La conclusion «quasi impossible» devient beaucoup moins évidente dès qu’on abandonne l’hypothèse d’indépendance.
2. Erreur du «procureur»
Le raisonnement présenté au jury confond deux probabilités différentes :
- [math]P(\text{décès des enfants} \mid \text{innocente})[/math] : probabilité d’observer deux morts naturelles si la mère est innocente (c’est ce que l’expert a tenté d’estimer).
- [math]P(\text{innocente} \mid \text{décès des enfants})[/math] : probabilité que la mère soit innocente sachant que deux morts ont été observées (ce qui intéresse le jury).
Ces deux quantités ne sont pas égales. Le lien correct passe par le théorème de Bayes :
P(\text{innocente}\mid \text{décès des enfants})
=\dfrac{P(\text{décès des enfants}\mid \text{innocente})P(\text{innocente})}
{P(\text{décès des enfants}\mid \text{innocente})P(\text{innocente})+P(\text{décès des enfants}\mid \text{coupable})P(\text{coupable})}.Pour interpréter correctement une preuve rare, il faut donc aussi connaître les fréquences de base :
- [math]P(\text{innocente})[/math] : a priori, la grande majorité des parents sont innocents.
- [math]P(\text{coupables})[/math] : les infanticides sont extrêmement rares.
- [math]P(\text{décès des enfants}\mid \text{coupable})[/math] : probabilité d’observer ces décès si la mère est coupable (souvent difficile à quantifier, et pas nécessairement proche de 1).
Petit exemple chiffré
Supposons un large ensemble de familles « comparables » :
- [math]P(\text{innocente})=0{,}99999[/math] (99,999 % de parents innocents).
- [math]P(\text{coupable})=0{,}00001[/math].
- [math]P(\text{deux morts naturelles}\mid \text{innocente})=1/5000000[/math] (ordre de grandeur «rare»).
- [math]P(\text{deux morts}\mid \text{coupable})=0{,}5[/math] (hypothèse illustrative : si coupable, forte probabilité d’observer deux décès).
Alors :
\begin{aligned}
P(\text{innocente}\mid \text{décès des enfants})
&=\dfrac{\frac{1}{5000000}\times 0{,}99999}
{\frac{1}{5000000}\times 0{,}99999 + 0{,}5\times 0{,}00001}
&\approx \dfrac{2\cdot 10^{-7}}{2\cdot 10^{-7}+5\cdot 10^{-6}}
\approx \dfrac{0{,}2}{0{,}2+5}
\approx 0{,}038.
\end{aligned}Ainsi, la probabilité d’innocence conditionnelle ressort autour de 4 % avec ces paramètres hypothétiques. On est donc loin des calculs du procureur!
Deux messages importants :
- La valeur finale dépend fortement des base rates (fréquences réelles d’infanticide, d’accidents, etc.) et de [math]P(\text{deux morts}\mid \text{coupable})[/math].
- On ne peut pas remplacer [math]P(\text{innocente}\mid \text{décès des enfants})[/math] par [math]P(\text{décès des enfants}\mid \text{innocente})[/math] : c’est la confusion au cœur du problème.
III. Réflexions et prolongements
1. L’importance d’une bonne utilisation des statistiques
L’affaire Sally Clark met en lumière à quel point les probabilités et statistiques sont des outils puissants, mais aussi dangereux lorsqu’ils sont mal compris.
Un calcul trompeur ou une confusion de raisonnement peut influencer un jury, un juge ou même des experts, et mener à des conséquences dramatiques, comme la condamnation injuste d’une mère innocente.
Cela souligne la nécessité d’une véritable éducation à la pensée statistique. Dans des domaines sensibles comme la justice, la médecine ou encore la finance, savoir interpréter correctement des probabilités peut changer totalement une décision.
2. Ouvertures possibles
Le cas de Sally Clark n’est pas isolé. On retrouve d’autres affaires judiciaires où des erreurs de raisonnement probabiliste ont joué un rôle central, notamment aux États-Unis et aux Pays-Bas.
Pour éviter ces confusions, on peut s’appuyer sur des outils adaptés, comme le théorème de Bayes, qui permet d’intégrer à la fois la rareté d’un événement et les fréquences de base pour évaluer correctement une probabilité conditionnelle. C’est une approche plus rigoureuse, mais encore trop rarement utilisée en dehors des milieux scientifiques.
Enfin, cette affaire pose une réflexion plus large : quel est le rôle des mathématiques dans la société ? Elles sont à la fois une aide précieuse à la décision (en modélisant l’incertitude), mais aussi un outil qui peut manipuler si les résultats sont mal présentés ou mal compris.
Le défi est donc double : apprendre à utiliser les statistiques correctement et à garder un regard critique sur leur utilisation.
Conclusion
L’affaire Sally Clark rappelle que les mathématiques sont de formidables outils d’aide à la décision, mais qu’une erreur de raisonnement peut, elle, coûter une vie.
On espère que ce sujet vous aidera, et que vous saurez l’exploiter au mieux pour briller à votre épreuve !