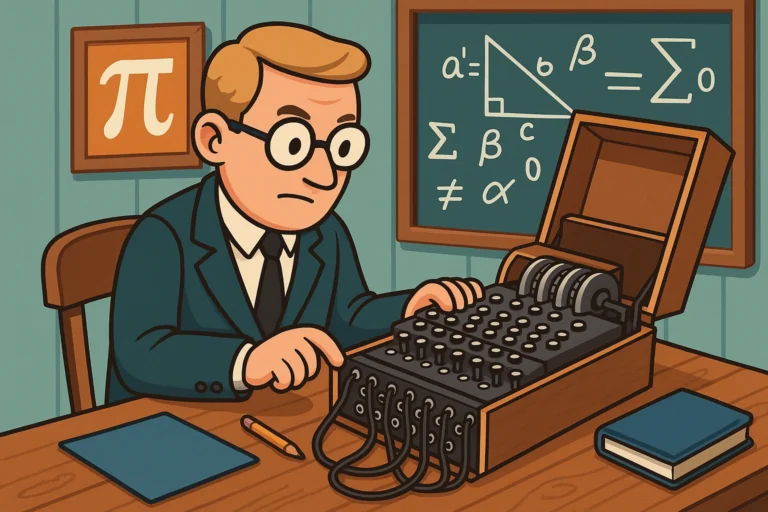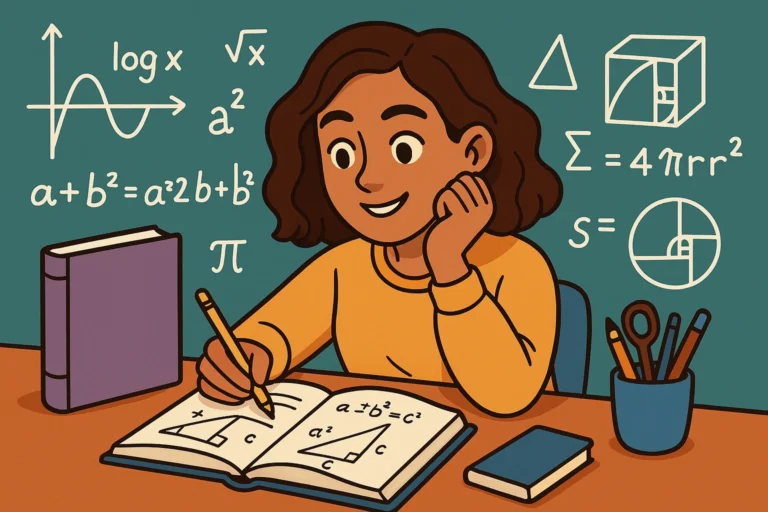L’histoire du zéro en mathématiques
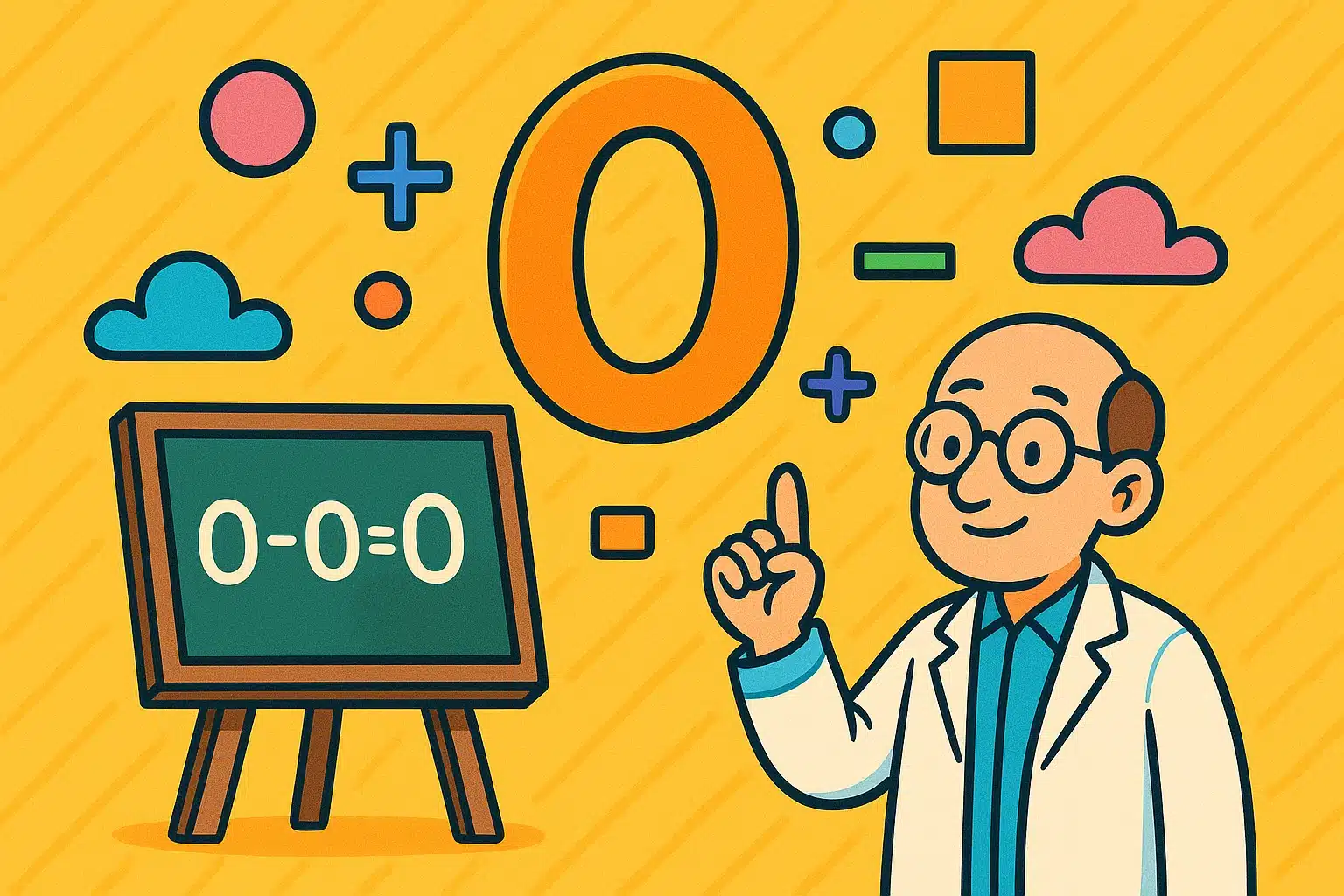
Introduction
Aujourd’hui, le zéro nous paraît évident : on l’utilise tous les jours dans les calculs, dans l’écriture des nombres… Pourtant, son invention a été une véritable révolution mathématique.
I. Aux origines du zéro
1. Des «manques» aux premières notations
L’idée du zéro ne s’est pas imposée immédiatement. Les Babyloniens, dès le IIIe siècle avant notre ère, utilisaient un système sexagésimal (base 60) et avaient besoin de marquer l’«absence» d’une valeur. Ils inséraient alors un espace ou un symbole pour signifier ce manque, mais ce n’était pas encore un vrai nombre : seulement un repère dans l’écriture.
C’est en Inde, au Ve siècle, que le zéro devient un véritable chiffre et même un nombre. Le mathématicien Brahmagupta, en 628, définit explicitement des règles de calcul avec zéro : il reconnaît son rôle central dans les opérations (addition, soustraction, multiplication).
2. Zéro comme chiffre de position
Avant l’invention du zéro, les systèmes comme les chiffres romains (XXVII, CCLXII, …) étaient longs et compliqués pour les calculs. Le passage au système décimal positionnel, avec le zéro comme symbole de «remplissage», a totalement simplifié les écritures et les opérations.
Exemple concret :
- En chiffres romains, calculer CCVII + LIII demande des manipulations fastidieuses.
- Avec le zéro, on écrit 207 + 53 = 260 de manière claire et rapide.
Ainsi, le zéro n’est pas qu’un simple chiffre : c’est l’élément qui rend possible toute la mécanique du système décimal, base de notre numération actuelle.
🔒 La suite est réservée aux membres Premium
Accédez à l’intégralité des 40 sujets rédigés pour le Grand Oral de Maths.
Je veux le Pack Premium