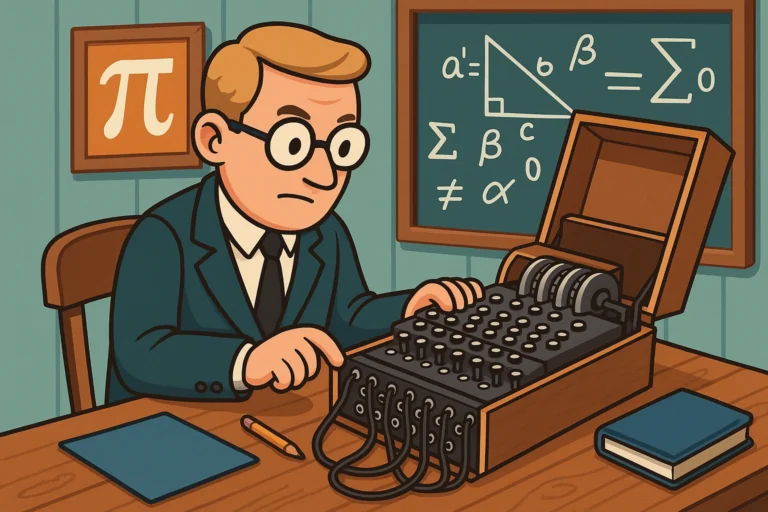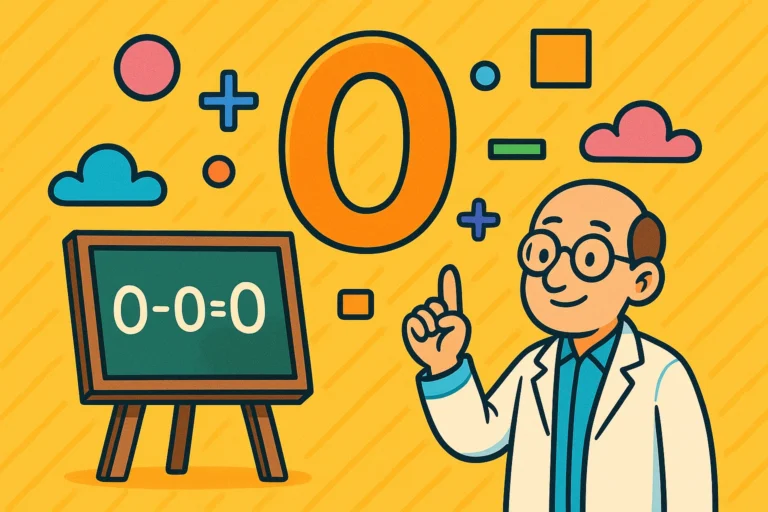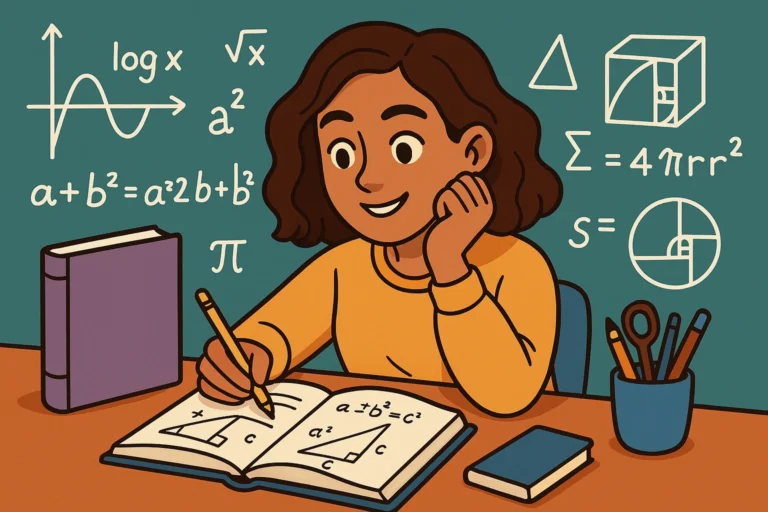Comment les mathématiques permettent-elles de classer les joueurs d’échecs ?

Introduction
Quand on joue aux échecs, on entend souvent dire qu’un joueur a «1800 Elo» ou «2500 Elo». Mais que signifient vraiment ces nombres ? Derrière ce classement mondial se cache une idée mathématique simple : transformer les résultats de parties en probabilités de victoire et les exprimer sur une échelle commune. Le système Elo repose donc sur des outils de calcul, de probabilités et de logarithmes, qui permettent de comparer équitablement les forces des joueurs, qu’ils soient débutants ou champions.
I. Origine et limites d’un classement basé sur les rapports de force
1. Le classement Elo et l’idée de «force»
Le système Elo part de l’idée que chaque joueur possède une «force», qu’on peut relier à une probabilité de victoire.
Supposons trois joueurs A, B et C, auxquels on attribue des probabilités absolues de gagner : [math]p(A) = 0{,}6[/math], [math]p(B) = 0{,}3[/math], [math]p(C) = 0{,}15[/math].
On définit alors le rapport de force entre deux joueurs comme le rapport de leurs probabilités :
X(A/B) = \dfrac{p(A)}{p(B)}.Exemple :
X(A/B) = \dfrac{0{,}6}{0{,}3} = 2,X(B/C) = \dfrac{0{,}3}{0{,}15} = 2,X(A/C) = \dfrac{0{,}6}{0{,}15} = 4.On retrouve bien la cohérence multiplicative :
X(A/C) = X(A/B) \times X(B/C).
Ensuite, on peut convertir ce rapport en probabilité de victoire relative entre A et B :
p(A,B) = \dfrac{X(A/B)}{1 + X(A/B)}.Exemple :
p(A,B) = \dfrac{2}{1+2} = \dfrac{2}{3} \approx 0{,}67.p(B,C) = \dfrac{2}{1+2} = \dfrac{2}{3}.p(A,C) = \dfrac{4}{1+4} = 0{,}8.Cela montre qu’à partir de probabilités de victoire individuelles, on peut définir des rapports de force cohérents et construire un classement global.
2. Limite d’un classement purement proportionnel
Mais ce modèle a une limite importante :
- Les joueurs faibles ont des forces très petites, donc un changement de quelques points est difficile à interpréter.
- Les joueurs très forts ont des forces énormes, où un petit écart peut représenter une grande différence réelle.
Exemple :
- Passer de [math]X=1[/math] à [math]X=2[/math] double la force relative, mais cela reste un niveau très bas.
- Passer de [math]X=1000[/math] à [math]X=1001[/math] ne change presque rien numériquement, mais peut pourtant représenter une différence sensible entre joueurs d’élite.
Problème : la comparaison n’est pas linéaire → il faut «compresser» les valeurs pour que les écarts aient toujours la même signification.
II. La solution mathématique : la transformation logarithmique
1. La fonction qui linéarise les écarts
On cherche une fonction [math]f[/math] telle que :
D(A,B) = f(p(A,B)),
et
D(A,B) + D(B,C) = D(A,C).
Cette condition impose une fonction logarithmique :
f(p) = C \cdot \log_b\left(\dfrac{p}{1-p}\right).Dans le système Elo, on choisit [math]b = 10[/math] et [math]C = 400[/math].
Ainsi, la différence de points Elo entre deux joueurs est :
D(A,B) = 400 \cdot \log_{10}\left(\dfrac{p(A,B)}{1-p(A,B)}\right).Exemple avec nos joueurs :
On avait trouvé :
p(A,B) = \tfrac{2}{3} \approx 0{,}67.Alors :
D(A,B) = 400 \cdot \log_{10}\left(\dfrac{0{,}67}{0{,}33}\right) \approx 400 \cdot \log_{10}(2) \approx 120.De même :
D(B,C) \approx 120.
Donc, par additivité :
🔒 La suite est réservée aux membres Premium
Accédez à l’intégralité des 40 sujets rédigés pour le Grand Oral de Maths.
Je veux le Pack Premium