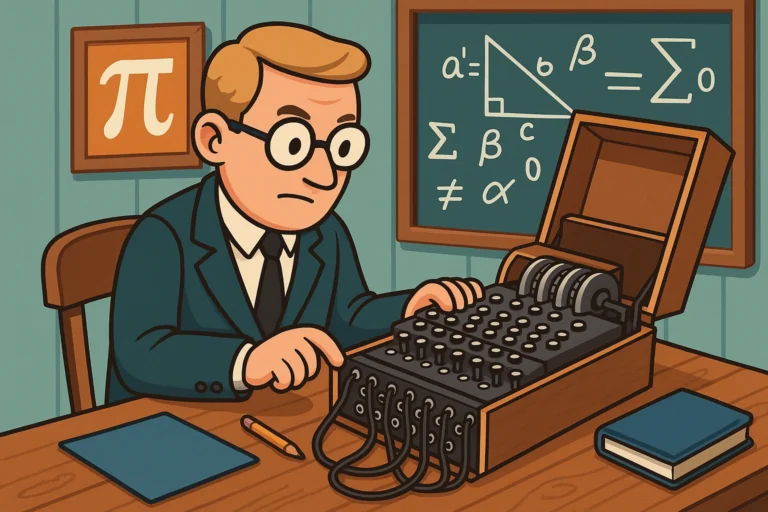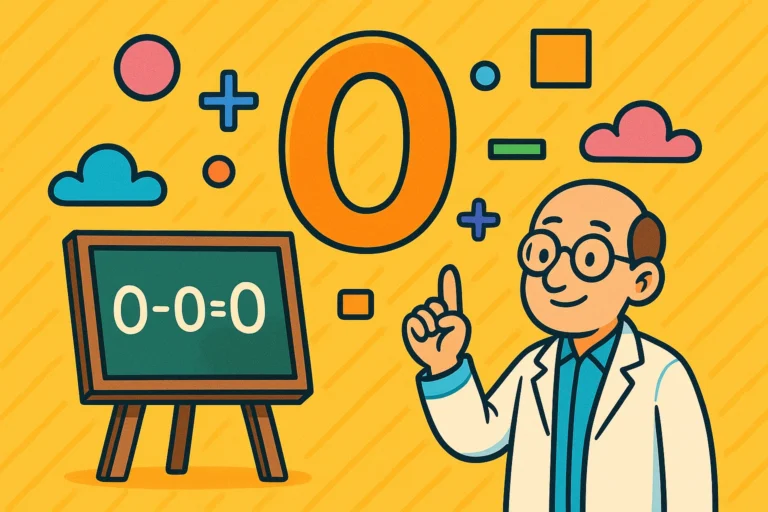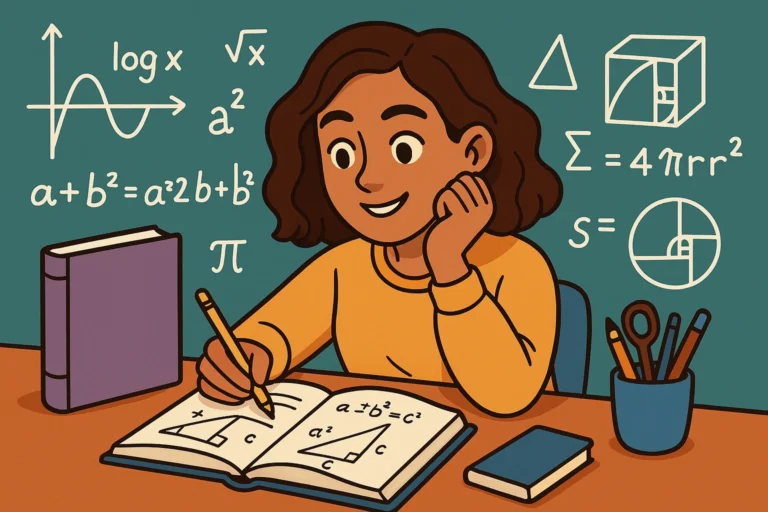Comment expliquer les impressions de déjà vu ?

Introduction
On a tous déjà eu cette sensation étrange : être persuadé d’avoir déjà vécu une situation alors que c’est impossible. Ce phénomène, qu’on appelle le «déjà-vu», intrigue autant les scientifiques que le grand public. Et si, derrière cette impression mystérieuse, les mathématiques pouvaient nous aider à y voir plus clair ?
I. Le phénomène de déjà-vu : description et hypothèses
1. Définition et fréquence
Le déjà-vu est cette impression étrange de revivre une scène que l’on sait pourtant nouvelle. Par exemple : entrer dans une pièce pour la première fois et avoir la sensation d’y être déjà allé. Ce sentiment est très répandu : les études montrent qu’environ 6 personnes sur 10 déclarent avoir déjà ressenti au moins une fois un déjà-vu au cours de leur vie.
Les scientifiques avancent plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène. L’une des plus étudiées est l’hypothèse neurobiologique : notre cerveau traite l’information visuelle par deux circuits légèrement différents, et si l’un d’eux envoie le signal avec un léger retard, on a l’impression que la scène a déjà été perçue. C’est un peu comme si on regardait deux fois le même film avec une fraction de seconde de décalage.
2. Hypothèse mnésique et rôle de la mémoire
Une autre explication met en avant la mémoire. Le déjà-vu correspondrait à une sorte d’«erreur de classement» : une nouvelle expérience est mal enregistrée et rangée dans la mémoire à long terme, donnant l’illusion qu’elle est déjà connue.
On peut modéliser cette idée avec un parallèle mathématique simple : imaginons que nos souvenirs soient comme une base de données. Chaque situation vécue est un «code» enregistré. Mais, avec le temps, des situations différentes peuvent produire des codes très proches : le cerveau confond alors la nouvelle expérience avec une ancienne → c’est ce qu’on appelle en informatique une collision.
Ce lien est important : il permet d’introduire les probabilités. En effet, si nous vivons des milliers de situations au cours de notre vie, il devient de plus en plus probable que certaines se ressemblent suffisamment pour créer cette impression de déjà-vu.
II. Modélisation mathématique du déjà-vu
1. Une question de probabilités : collisions et «paradoxes»
Idée-clé : modélisons chaque situation vécue comme un code mnésique parmi [math]N[/math] catégories possibles (par ex. combinaison «lieu × luminosité × personnes × humeur»). Si l’on vit [math]n[/math] situations dans un laps de temps, une impression de déjà-vu peut apparaître dès que deux codes coïncident (collision), même si les scènes ne sont pas exactement identiques.
- Probabilité qu’aucune collision n’apparaisse (analogue du paradoxe des anniversaires) :
P(\text{tous différents}) = \prod_{k=0}^{n-1}\left(1-\frac{k}{N}\right)
\approx \exp\left(-\frac{n(n-1)}{2N}\right)
\quad\text{(pour } n\ll \sqrt{N}\text{)}.Donc
P(\text{au moins une ressemblance})
= 1 - P(\text{tous différents})
\approx 1 - \exp\left(-\frac{n(n-1)}{2N}\right).Seuil 50 % (règle «anniversaire»)
Résoudre [math]\exp\big(-\tfrac{n(n-1)}{2N}\big)=\tfrac12[/math] donne
n \approx \sqrt{2N\ln 2} \approx 1{,}177\sqrt{N}.Autrement dit, il ne faut pas « [math]\tfrac{N}{2}[/math] » situations pour que les collisions deviennent probables, mais seulement un nombre proportionnel à [math]\sqrt{N}[/math].
🔒 La suite est réservée aux membres Premium
Accédez à l’intégralité des 40 sujets rédigés pour le Grand Oral de Maths.
Je veux le Pack Premium