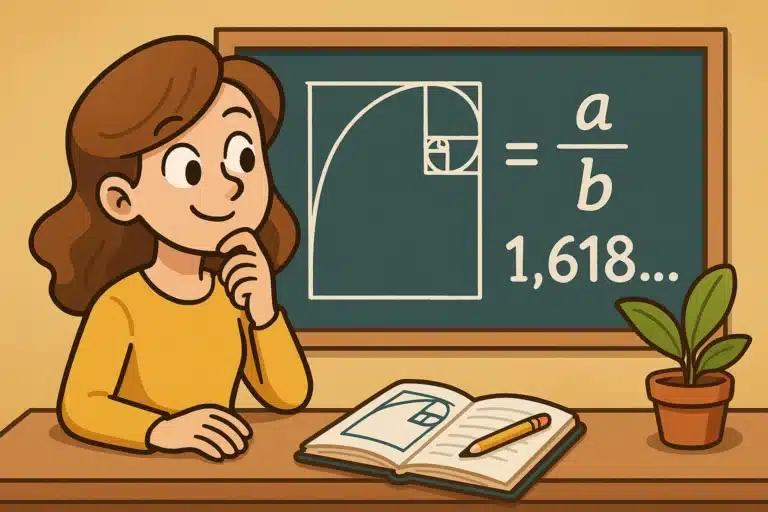Mathématiques et physique en Formule 1

Introduction
Tout le monde connaît la Formule 1 comme un sport de vitesse et de spectacle. Mais derrière chaque virage et chaque dépassement, il y a en réalité énormément de mathématiques et de physique : trajectoires optimisées, forces aérodynamiques, gestion des pneus et même stratégies de course. C’est ce que nous allons voir aujourd’hui.
I. La vitesse et les trajectoires
1. Les trajectoires idéales
Lorsqu’une Formule 1 aborde un virage, la question est simple : comment aller le plus vite possible sans sortir de la piste ?
Mathématiquement, un virage peut être modélisé comme un arc de cercle de rayon [math]R[/math].
La force qui agit sur la voiture est la force centrifuge (ou plutôt la force centripète nécessaire pour maintenir la trajectoire circulaire) :
F = \tfrac{mv^2}{R}où :
- [math]m[/math] est la masse de la voiture,
- [math]v[/math] sa vitesse,
- [math]R[/math] le rayon de courbure.
Cela signifie que plus la vitesse est grande, plus la force demandée est énorme, car [math]v^2[/math] apparaît au numérateur.
L’astuce des pilotes est donc d’agrandir le rayon [math]R[/math] du virage :
- Si on prend le virage « à la corde » (le point le plus intérieur), le rayon est petit → on doit ralentir beaucoup.
- Si on prend une trajectoire plus large (extérieur → corde → extérieur), le rayon est plus grand → on peut passer plus vite.
L’idée est donc de parcourir une distance un peu plus grande, mais à une vitesse bien plus élevée, ce qui réduit le temps total.
2. Les équations différentielles du mouvement
Après un virage, la voiture accélère de nouveau.
Sa vitesse [math]v(t)[/math] obéit à l’équation différentielle :
\tfrac{dv}{dt} = \tfrac{F_\text{moteur} - F_\text{résistances}}{m}.- Le moteur pousse la voiture ([math]F_\text{moteur}[/math]),
- Les frottements mécaniques et l’air s’y opposent ([math]F_\text{résistances}[/math], souvent proportionnelle à [math]v^2[/math]),
- Le tout est divisé par [math]m[/math], la masse de la voiture.
Cette équation montre qualitativement que :
- Au départ, [math]F_\text{moteur}[/math] est largement supérieur → la vitesse augmente vite.
- Mais plus [math]v[/math] grandit, plus [math]F_\text{résistances}[/math] augmente.
- Finalement, on atteint un équilibre où [math]F_\text{moteur} = F_\text{résistances}[/math] → la vitesse ne croît plus, elle tend vers une vitesse limite asymptotique.
En course, cette asymptote dépend de l’aérodynamique et de la puissance du moteur : une F1 est conçue pour que cette vitesse maximale soit très élevée sur les lignes droites, mais modulée en virage par la force centrifuge et l’adhérence des pneus.
II. Les forces en jeu : aérodynamique et frottements
1. La portance inversée (loi en [math]v^2[/math])
En aéronautique, les ailes génèrent une portance qui soulève l’avion. En Formule 1, c’est l’inverse : les ailerons sont conçus pour plaquer la voiture au sol. On parle alors de force d’appui aérodynamique.
La formule est :
F_\text{aéro} = \tfrac{1}{2}\rho S C_z v^2où :
- [math]\rho[/math] est la densité de l’air,
- [math]S[/math] la surface de référence,
- [math]C_z[/math] le coefficient aérodynamique,
- [math]v[/math] la vitesse.
On voit que cette force croît comme [math]v^2[/math].
Cela explique pourquoi :
- à basse vitesse (dans les stands), une F1 a une adhérence limitée,
- mais à haute vitesse, l’appui devient énorme, ce qui permet à la voiture de négocier les virages à des vitesses impossibles pour une voiture «normale».
Comparons avec la force centrifuge en virage [math]F = \tfrac{mv^2}{R}[/math] :
les deux forces croissent en [math]v^2[/math], mais l’appui augmente la capacité des pneus à supporter cette force → la F1 peut tourner bien plus vite qu’une voiture de route.
Vidéo super intéressante à aller visionner :
2. Optimisation pneus et frottements
Le deuxième ingrédient, ce sont les pneus.
Leur adhérence est modélisée par la loi de Coulomb :
F_f \leq \mu N,
où :
- [math]\mu[/math] est le coefficient de frottement pneu/sol,
- [math]N[/math] est la force normale qui appuie sur les pneus.
Mais [math]N[/math] n’est pas seulement le poids [math]mg[/math] : en Formule 1, il est augmenté par la force aérodynamique [math]F_\text{aéro}[/math].
Résultat :
- plus l’appui aérodynamique est fort, plus la force de frottement maximale est grande, donc meilleure adhérence.
- Cela permet aux F1 de prendre des virages très serrés sans déraper.
Mais il y a un compromis mathématique :
- Augmenter l’appui → plus d’adhérence en virage, mais aussi plus de traînée aérodynamique, donc une vitesse de pointe plus faible en ligne droite.
- Diminuer l’appui → on va plus vite sur les lignes droites, mais on perd en stabilité dans les virages.
En pratique, les ingénieurs doivent résoudre un problème d’optimisation : trouver le réglage qui minimise le temps total sur l’ensemble du circuit, en tenant compte de sa configuration (circuit avec longues lignes droites comme Monza ≠ circuit avec beaucoup de virages comme Monaco).
III. Stratégie et modélisation : mathématiques appliquées en course
1. Gestion des arrêts au stand
En Formule 1, les pneus s’usent vite. Plus ils sont usés, plus la voiture perd du temps par tour.
Mais changer de pneus coûte cher : un arrêt au stand prend environ 25 secondes.
On peut donc modéliser le problème ainsi :
- sans arrêt, chaque tour est de plus en plus lent (pneus usés),
- avec un arrêt, on perd 25 s tout de suite, mais ensuite chaque tour est plus rapide (pneus neufs).
Mathématiquement, c’est un problème d’optimisation discrète :
on compare des suites du type :
T_\text{total}(n_\text{arrêts}) = n_\text{tours}\times t_\text{moyen}(pneus) + 25\times n_\text{arrêts}.Exemple concret :
- Un pilote met 80 s par tour avec pneus neufs.
- Mais ses temps augmentent de 0,5 s par tour à cause de l’usure.
- Après 20 tours, il a perdu 10 s.
→ Il est plus rentable de changer de pneus avant, si l’arrêt de 25 s est compensé par le gain de performance sur la durée.
C’est exactement une question de minimisation : choisir le nombre d’arrêts qui donne le temps total le plus petit.
2. Simulation numérique et analyse de données
Aujourd’hui, les écuries ne se contentent pas de calculs simples.
Elles utilisent :
- des équations différentielles couplées pour modéliser la voiture sur tout le circuit : accélération, freinage, consommation de carburant, usure des pneus ;
- du big data : des milliers de capteurs sur la voiture envoient des données en temps réel (température des pneus, régime moteur, aérodynamique).
Ces données sont ensuite filtrées et traitées à l’aide d’outils mathématiques :
- algèbre linéaire (matrices, projections) pour combiner plusieurs signaux,
- statistiques pour éliminer le bruit et anticiper l’évolution (exemple : prédire le nombre de tours restants avant qu’un pneu perde trop d’efficacité).
On retrouve une idée de contrôle optimal : choisir à chaque instant l’action (attaquer, économiser les pneus, faire un arrêt) qui minimise le temps total de course, en tenant compte de toutes les contraintes physiques et mécaniques.
Conclusion
Ainsi, la Formule 1, ce n’est pas que de la vitesse : c’est aussi des mathématiques et de la physique à chaque instant de la course.
On espère que ce sujet vous aidera, et que vous saurez l’exploiter au mieux pour briller à votre épreuve !