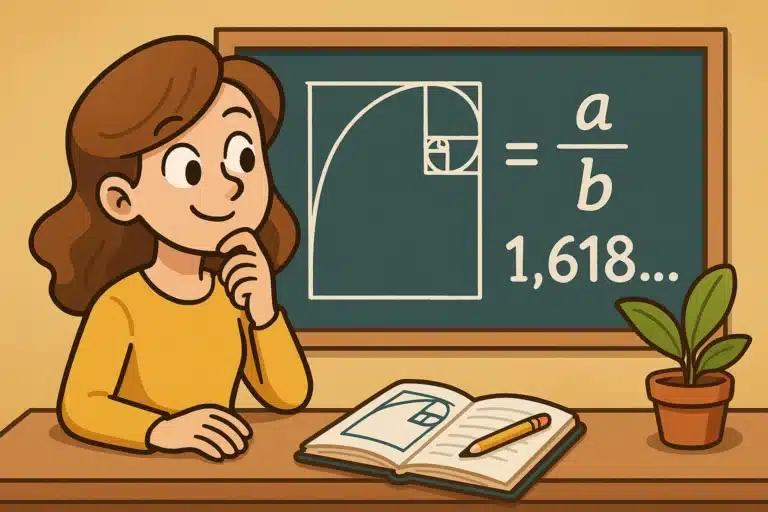Finance : les intérêts composés

Introduction
Quand on place de l’argent, il rapporte des intérêts. Mais il faut distinguer deux façons de les calculer : intérêts simples ou intérêts composés. Dans le premier cas, les intérêts s’ajoutent toujours au capital de départ ; dans le second, ils s’ajoutent au capital déjà augmenté, et donc produisent à leur tour des intérêts.
I. Intérêts simples vs composés
1. Définitions et modèles de suites
En finance, il est important de bien distinguer deux façons de calculer les intérêts :
- Les intérêts simples : le capital de départ ne change pas, et les intérêts sont calculés toujours sur ce capital initial.
On obtient alors une suite arithmétique : [math]U_k = U_0 (1 + kr)[/math]où :- [math]U_0[/math] est le capital de départ,
- [math]r[/math] est le taux annuel,
- [math]k[/math] est le nombre d’années.
- Les intérêts composés : ici, les intérêts s’ajoutent au capital à chaque période de capitalisation.
Cela correspond à une suite géométrique :[math]U_k = U_0 \left(1 + \dfrac{r}{N}\right)^{Nk}[/math]où :- [math]N[/math] est le nombre de fois où les intérêts sont capitalisés dans l’année (1 = annuel, 12 = mensuel, 52 = hebdomadaire…),
- [math]Nk[/math] est donc le nombre total de périodes écoulées en [math]k[/math] années.
2. Lecture graphique et interprétation
Si l’on trace sur un même graphique les deux modèles (avec le même capital initial [math]U_0[/math] et le même taux [math]r[/math]) :
- La courbe des intérêts simples est linéaire : elle croît régulièrement.
- La courbe des intérêts composés est convexe (en forme de courbe exponentielle) : elle croît de plus en plus vite.
L’écart entre les deux ne cesse de grandir avec le temps.
II. Capitalisation discrète vs limite continue : du mensuel à l’exponentiel
1. «4 % composés mensuellement» : sens et comparaison
Lorsqu’on parle d’un taux de 4 % composés mensuellement, cela ne signifie pas 4 % chaque mois, mais bien 4 % par an, répartis et ajoutés au capital en douze fois, c’est-à-dire à chaque mois.
Voici les formules selon la fréquence de capitalisation :
- Capitalisation annuelle :
[math]U_k = U_0 (1+r)^k[/math] - Capitalisation mensuelle :
[math]U_k = U_0 \left(1 + \dfrac{r}{12}\right)^{12k}[/math] - Capitalisation hebdomadaire :
[math]U_k = U_0 \left(1 + \dfrac{r}{52}\right)^{52k}[/math]
Plus la capitalisation est fréquente, plus le capital final est élevé. Cependant, l’écart devient de plus en plus faible (annuel < mensuel < hebdomadaire < …).
Un graphe comparatif sur quelques années permet de bien visualiser cette différence : la courbe «sature» et tend vers une limite exponentielle.
2. Développement limité et passage à l’exponentielle
On peut justifier mathématiquement cette convergence grâce au développement limité.
Lorsque [math]N \to \infty[/math], on a :
\left(1+\dfrac{r}{N}\right)^{N} \to e^{r}.En effet :
\ln\left(1+\dfrac{r}{N}\right) = \dfrac{r}{N} + o\left(\dfrac{1}{N}\right).Donc :
\left(1+\dfrac{r}{N}\right)^{Nk} \approx e^{rk}.Ainsi, si on capitalise de plus en plus souvent, le modèle des intérêts composés tend vers une croissance exponentielle :
U_k \approx U_0 e^{rk}.III. Temps de doublement et «règle des 72»
1. Résolution exacte et approximation
Une question classique en finance est : en combien de temps mon capital va-t-il doubler ?
On cherche donc [math]k[/math] tel que :
U_k = 2U_0.
- Cas discret (capitalisation annuelle) :
[math](1+r)^k = 2 \Rightarrow k = \dfrac{\ln 2}{\ln(1+r)}[/math] - Cas continu (approximation) :
[math]e^{rk} = 2 \Rightarrow k \approx \dfrac{\ln 2}{r} \approx \dfrac{0{,}693}{r}[/math]
On obtient une formule simple qui relie le taux d’intérêt [math]r[/math] au temps nécessaire pour doubler le capital.
2. Règle des 72 et astuce de calcul mental
Plutôt que de sortir sa calculatrice, on peut utiliser une approximation rapide : la règle des 72.
Elle dit que : [math]\text{Temps de doublement} \approx \dfrac{72}{100 \times r%}[/math]
Exemple : avec un taux annuel de 4 %, on obtient environ [math]\dfrac{72}{4} = 18[/math] ans pour doubler le capital.
- Parce que c’est un bon compromis de précision pour des taux « courants » (3 à 12 %).
- Et surtout parce que 72 possède beaucoup de diviseurs (2, 3, 4, 6, 8, 9, 12…), ce qui rend les calculs de tête très pratiques.
Par comparaison, 70 a moins de diviseurs, et 69,3 serait plus précis (car [math]\ln 2 \times 100 \approx 69{,}3[/math]) mais beaucoup moins pratique à utiliser mentalement.
Conclusion
Les intérêts simples donnent une croissance régulière, mais les intérêts composés transforment vite l’évolution en une véritable courbe exponentielle. Avec la règle des 72, on voit même qu’il est possible d’estimer de tête en combien d’années son capital double…
Les intérêts composés paraissent séduisants sur le papier, mais en réalité, ils ne profitent qu’à ceux qui possèdent déjà beaucoup d’argent. Plus le capital est grand, plus il grossit vite : c’est un mécanisme qui creuse les inégalités au lieu de les réduire. Autrement dit, les intérêts ne créent pas de richesse réelle, ils déplacent simplement l’argent… des plus pauvres vers les plus riches. C’est pourquoi, même si le concept est mathématiquement intéressant, son usage est souvent critiqué et peu recommandé d’un point de vue purement social.
On espère que ce sujet vous aidera, et que vous saurez l’exploiter au mieux pour briller à votre épreuve !