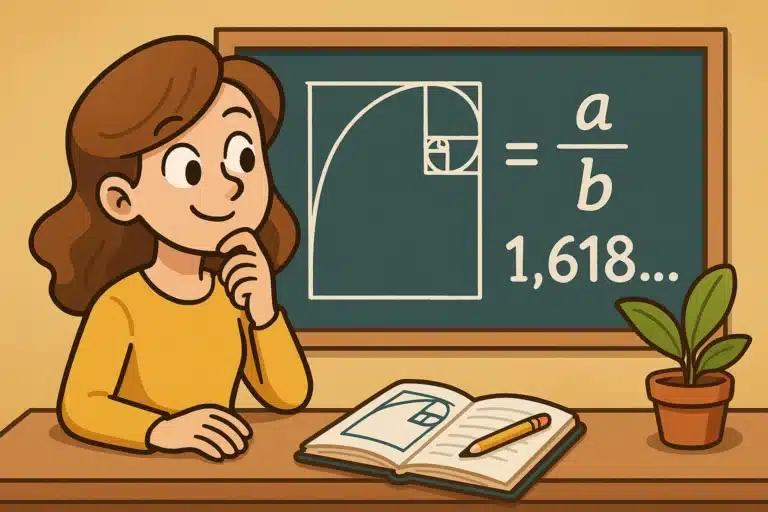Quel est l’impact des mathématiques sur l’intelligence artificielle ?
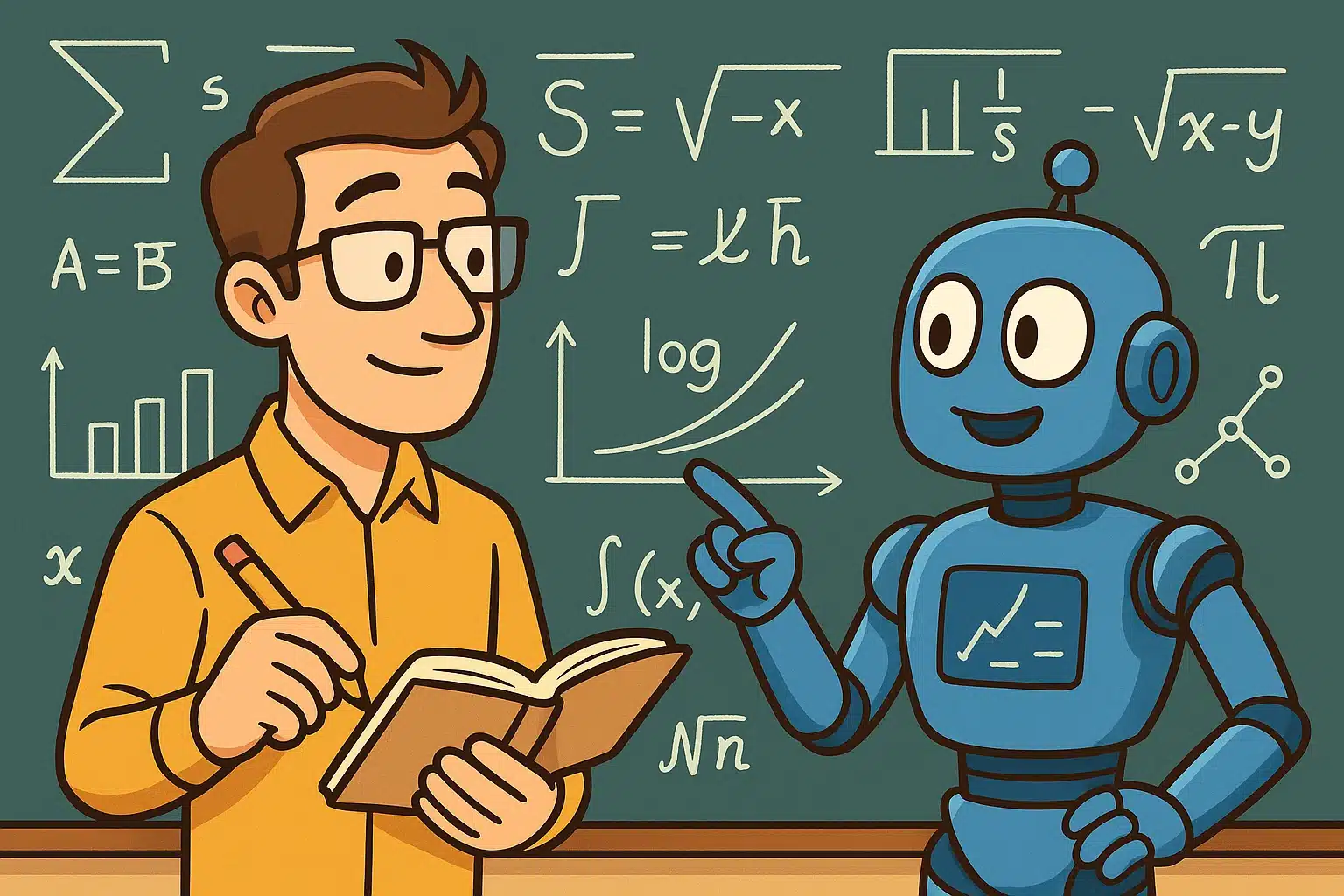
Introduction
Aujourd’hui, on parle beaucoup d’intelligence artificielle, que ce soit pour reconnaître des visages, traduire des textes ou encore générer des images. Mais derrière ce côté technologique impressionnant, il faut se rappeler que l’IA repose avant tout… sur des mathématiques.
Vecteurs, fonctions, probabilités, dérivées : tous ces outils sont en réalité les briques de base qui permettent aux machines d’apprendre à «réfléchir».
I. Les mathématiques comme fondement de l’IA
1. Les vecteurs et les matrices : le langage de l’IA
En intelligence artificielle, toutes les données sont représentées sous forme de vecteurs.
Par exemple, une image en niveaux de gris de taille [math]28 \times 28[/math] pixels peut être vue comme un grand vecteur de dimension [math]784[/math] (puisque [math]28 \times 28 = 784[/math]). Chaque pixel correspond à une coordonnée du vecteur, qui prend une valeur entre 0 (noir) et 255 (blanc).
Les transformations appliquées à ces vecteurs sont modélisées par des matrices.
Si [math]X[/math] est un vecteur de données et [math]A[/math] une matrice de coefficients (aussi appelés poids), alors la sortie [math]Y[/math] est donnée par :
Y = A \cdot X.
Exemple concret : une matrice de rotation en dimension 2, pour tourner un point [math]x,y[/math] d’un angle [math]\theta[/math], est :
R(\theta) =
\begin{pmatrix}
\cos \theta & -\sin \theta \\
\sin \theta & \cos \theta
\end{pmatrix}Ainsi, l’image (ou un vecteur de coordonnées) peut être transformée en multipliant par [math]R(\theta)[/math]. C’est exactement ce type de calcul matriciel qui est au cœur des réseaux de neurones modernes.
2. Les fonctions et la modélisation
L’objectif d’une IA est d’apprendre une fonction [math]f[/math] telle que :
f(x) \approx y,
où [math]x[/math] désigne les données d’entrée (par exemple, les pixels d’une image), et [math]y[/math] la sortie attendue (par exemple, « chat » ou « chien »).
Un exemple simple est la régression linéaire en 2D, où l’on cherche une fonction affine :
y = ax + b.
On ajuste les paramètres [math]a[/math] (pente) et [math]b[/math] (ordonnée à l’origine) pour que la droite passe au mieux par les points d’un nuage de données. Dans l’idée c’est ce que fait l’IA : approximer une relation entre des variables.
Mais «apprendre» une fonction veut dire trouver les bons paramètres (ici [math]a[/math] et [math]b[/math]) pour minimiser l’erreur. C’est là qu’interviennent l’optimisation et les probabilités…
II. Optimisation et probabilités : apprendre à partir des données
1. Optimisation par les dérivées
Lorsqu’on entraîne une IA, on cherche à ce que la fonction trouvée «colle» le mieux possible aux données. Pour mesurer la qualité d’un modèle, on introduit une erreur (ou fonction de coût).
Dans le cas d’une régression linéaire [math]y = ax + b[/math], une mesure classique de l’erreur est l’erreur quadratique:
E(a,b) = \sum_{i=1}^n \big( y_i - (ax_i + b) \big)^2où [math]x_i,y_i[/math] sont les points du nuage.
Exemple concret : imaginons 3 points [math](1,2)[/math], [math](2,3)[/math], [math](3,6)[/math].
- Si on choisit la droite [math]y = x+1[/math], alors les erreurs valent : [math](2 – (1+1))^2 = 0[/math], [math](3 – (2+1))^2 = 0[/math], [math](6 – (3+1))^2 = 4[/math]. Donc [math]E = 4[/math].
- Si on prend [math]y = 2x[/math], alors : [math](2 – 2)^2 = 0[/math], [math](3 – 4)^2 = 1[/math], [math](6 – 6)^2 = 0[/math]. Donc [math]E = 1[/math], ce qui est mieux.
On comprend que la «bonne» droite est celle qui minimise [math]E[/math], c’est-à-dire qui a l’erreur la plus petite possible.
En pratique, quand il y a des milliers de points, on ne peut pas tester toutes les droites. Les IA utilisent alors une méthode appelée descente de gradient :
- on part d’une droite «au hasard»,
- on calcule si l’erreur augmente ou diminue quand on change légèrement [math]a[/math] ou [math]b[/math],
- puis on ajuste petit à petit dans le sens qui fait baisser l’erreur.
Répétée de nombreuses fois, cette méthode permet de trouver progressivement la droite la plus proche du nuage de points.
2. Rôle des probabilités et statistiques
Une IA ne «décide» pas de manière absolue : elle renvoie souvent une probabilité.
Par exemple, pour une image donnée, le modèle peut donner :
P(\text{chat}) = 0{,}8, \quad P(\text{chien}) = 0{,}2.Cela signifie que l’IA estime à 80 % que l’image est un chat.
Cette idée repose directement sur la loi des grands nombres : si un événement a une probabilité réelle [math]p[/math], alors en répétant l’expérience un grand nombre de fois, la fréquence observée se rapproche de [math]p[/math].
Exemple concret :
Imaginons un modèle de traduction qui prédit le mot suivant. Si, sur 100 phrases commencées par «Les mathématiques sont…», il propose « utiles » 72 fois, alors on peut estimer :
\hat{p} = \frac{72}{100} = 0{,}72.Si on augmente le nombre d’exemples à 1000 ou 10 000 phrases, la fréquence observée se rapprochera encore plus de la probabilité réelle que le modèle attribue au mot « utiles ».
Dans l’IA, plus on a de données (images, textes, sons…), plus les estimations de probabilité sont fiables, et plus les prédictions deviennent justes.
Si vous voulez aller plus loin sur la partie proba/stat en IA, voici une vidéo qui pourrait vous aider:
3. Réseaux de neurones
Jusqu’ici, nous avons vu des modèles assez simples : une droite pour approximer une relation (régression linéaire), ou bien des probabilités pour estimer un résultat. Mais l’IA moderne repose sur des modèles beaucoup plus puissants, capables de combiner ces idées et de traiter des données complexes. C’est le rôle des réseaux de neurones artificiels.
Un réseau de neurones artificiels est construit à partir de briques mathématiques simples : les neurones.
Chaque neurone reçoit plusieurs entrées [math]x_1, x_2, \dots, x_n[/math] (par exemple, des pixels d’une image), leur associe des poids [math]w_1, w_2, \dots, w_n[/math], et calcule une somme pondérée :
z = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b
où [math]b[/math] est un biais (un paramètre supplémentaire qui décale la sortie).
Ensuite, le neurone applique une fonction d’activation, souvent non linéaire. Exemple : la fonction sigmoïde :
f(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.Cette fonction a la propriété de transformer tout nombre réel en une valeur comprise entre 0 et 1, ce qui peut être interprété comme une probabilité.
Exemple numérique :
- Pour [math]z = 0[/math], [math]f(0) = \tfrac{1}{1+e^0} = \tfrac{1}{2} = 0{,}5[/math].
- Pour [math]z = 2[/math], [math]f(2) \approx \tfrac{1}{1+e^{-2}} \approx 0{,}88[/math].
On voit que la sortie se rapproche de 1 lorsque [math]z[/math] est grand, et de 0 lorsque [math]z[/math] est très négatif.
Ainsi, un réseau de neurones est simplement une composition de fonctions mathématiques (sommes pondérées + fonctions non linéaires). Mais cette combinaison permet de modéliser des relations extrêmement complexes entre les données.
Concrètement, cela veut dire que si on donne à un réseau de neurones des milliers d’images de chats et de chiens, il apprend peu à peu à associer certaines caractéristiques (formes, couleurs, textures) à une catégorie. À la fin, il est capable de reconnaître une nouvelle image jamais vue et de dire s’il s’agit plutôt d’un chat ou d’un chien.
III. Applications et limites de l’IA
Ces outils mathématiques se retrouvent dans de nombreuses applications :
- Reconnaissance d’images : comme on a pu le voir.
- Traitement du langage : un texte est modélisé statistiquement, par exemple en estimant la probabilité qu’un mot suive un autre (chaînes de Markov). Exemple : si l’on écrit «Les mathématiques sont», il est plus probable que le mot suivant soit «utiles» que «bananes».
- Prédiction en médecine : l’IA peut analyser des données médicales (images, mesures, statistiques) pour estimer la probabilité qu’un patient développe une maladie. On utilise alors les probabilités et les fonctions de régression pour anticiper un diagnostic ou choisir le traitement le plus adapté.
Mais l’IA a aussi des limites mathématiques.
Un problème classique est le sur-apprentissage (overfitting). Cela se produit quand le modèle s’adapte trop parfaitement aux données d’entraînement, au point qu’il «apprend par cœur» et n’est plus capable de généraliser.
Exemple : si on entraîne une IA à reconnaître des chats uniquement sur des images de chats noirs, elle risque de penser qu’un chat blanc n’est pas un chat.
Conclusion
Ainsi, l’intelligence artificielle n’est pas de la magie, mais bien l’application concrète des mathématiques. C’est la preuve que les maths ne sont pas que théoriques : elles transforment vraiment notre quotidien 🙂
On espère que ce sujet vous aidera, et que vous saurez l’exploiter au mieux pour briller à votre épreuve !